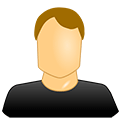Reportage diffusé lors de la présentation du match Toulouse/Toulon, sur un des joueurs les plus mythique du rugby professionnel.
Né dans une famille de sportifs, il pratique très jeune le rugby à XV. Lors de l’été 1997, Wilkinson entame sa carrière professionnelle chez les Newcastle Falcons. Avec eux, il remporte l’Allied Dunbar Premiership dès sa première saison. Il est retenu en sélection nationale pour la première fois à l’âge de 18 ans. Il devient célèbre au cours des saisons 2001-2002 et 2002-2003, période durant laquelle il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde
Ses succès sont généralement attribués à sa très bonne hygiène de vie, à la rigueur et la longueur de ses entraînements. Sa récente conversion au bouddhisme lui à permis d’acquérir assez de force mentale pour sortir d’une période noire longue de 3 ans et de revenir au-devant de la scène avec un club français.
Jonny Wilkinson est toujours l’un des joueurs de rugby à XV les plus populaires1, et il cumule nombre de records. Le 6 octobre 2007, il devient le plus grand marqueur de l’histoire de la Coupe du monde, dépassant l’Écossais Gavin Hastings en butant quatre pénalités en quart de finale contre l’Australie10. Lors du Tournoi des Six Nations 2008, il devient le premier joueur anglais et le second joueur mondial à passer la barre des 1 000 points marqués.
En mars 2008, il devient le plus grand marqueur du rugby international, dépassant le Gallois Neil Jenkins, avant de perdre le record à son tour au profit du Néo-Zélandais Dan Carter. Ses succès sont généralement attribués à sa très bonne hygiène de vie, à la rigueur et la longueur de ses entraînements ainsi qu’à sa force mentale. Néanmoins, la masse de travail fournie par le joueur anglais et son engagement ont beaucoup fatigué et meurtri son corps.
Avec le puissant et rapide Jonah Lomu, c’est le joueur de rugby qui a le plus d’impact sur ce sport depuis la professionnalisation du rugby à XV en 1995. Wilkinson est lié à l’équipementier Adidas et fait la promotion d’autres partenaires. (source wikipédia)